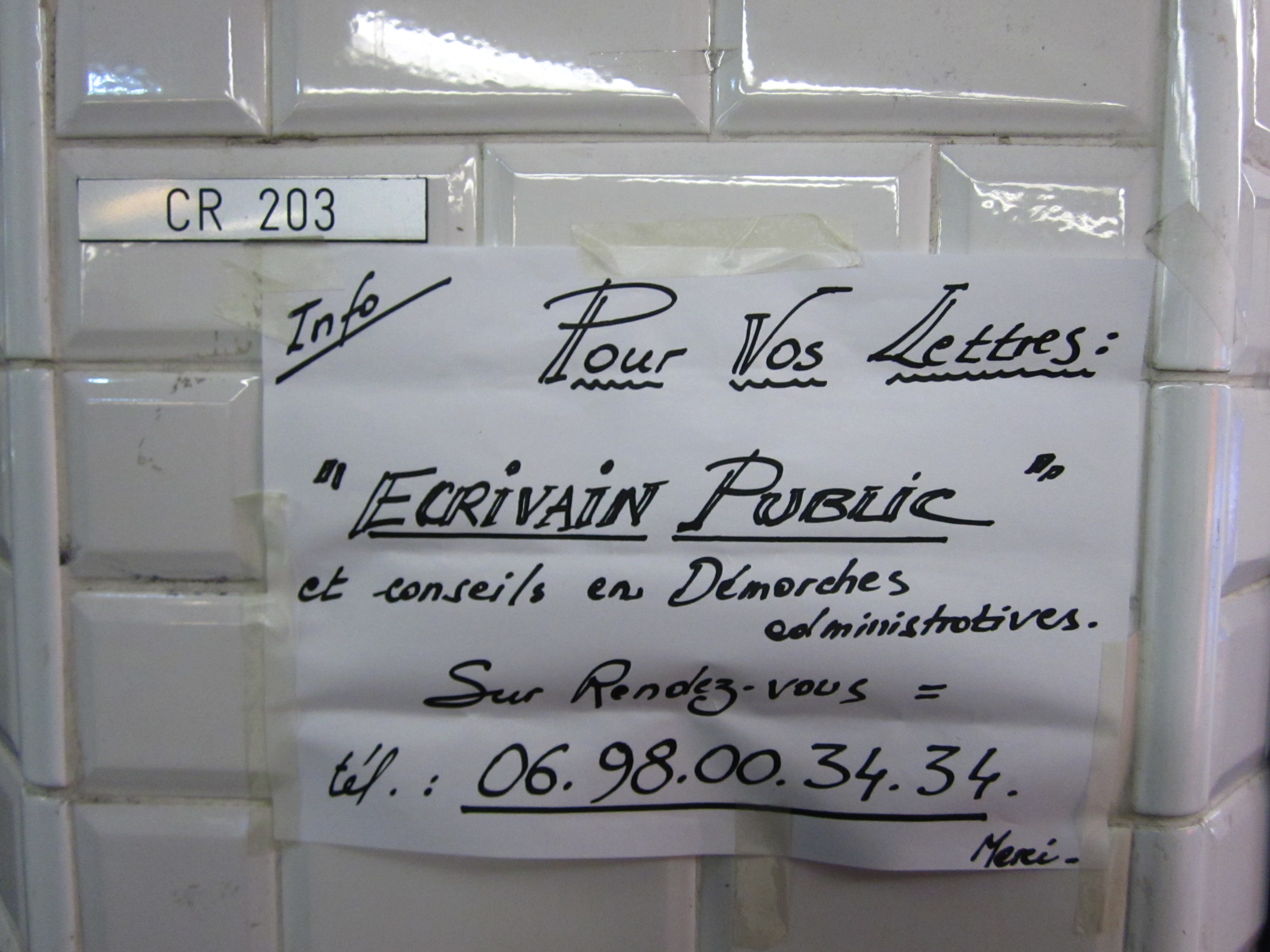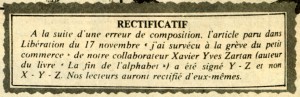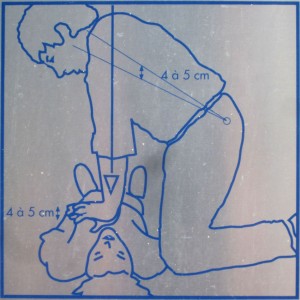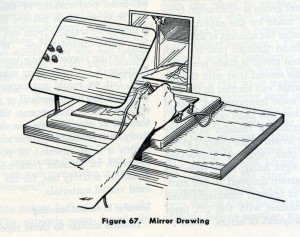18 juin 1992
[Journal de bord — Extraits.]
Hier, fin d’après-midi, petit détour à La Guilde, une librairie de livres anciens tenu par un ancien ami de clandestinité de mon père, Johan. Ébauche de discussions et d’un seul coup, quelques confidences glanées. Il semble qu’il se soit brouillé avec mon père, non pas tant sur une histoire de réappropriation escroque de la librairie du groupuscule trotskiste dissident où papa militait, mais sur une histoire de cul concernant une certaine Annie Économos (?) dont j’ai toujours vaguement entendu parler. Je glisse. Il ajoute que mon père, à la fin de sa période de résistance clandestine, en 1948 – persécution stalinienne oblige –, a choisi contrairement à lui de devenir un « sorbonnard ». Sa vision des choses. Un secret qu’il me tient à cœur de percer. J’explique au vieil anar individualiste Johan, allemand exilé qui a appris le français dans Voyage au bout de la nuit (eh oui, ça s’invente pas !), que mon père espérait sûrement changer l’Institution de l’intérieur et réaliser ses idéaux égalitaires par la voie novatrice des sciences humaines. Il opine lointainement. Je l’interroge sur les années 30. Il m’évoque ses virées à travers la Scandinavie avec 4 marks en poche et l’espéranto pour outrepasser les frontières idiomatiques du nationalisme, les seuls insurmontables pour les prolétaires d’alors. Il se souvient que Staline et Hitler ont interdit l’espéranto presque au même moment… Encore un signe des temps. Johan est en train d’écrire ses mémoires à partir d’un journal tenu à l’époque, où mon père apparaît souvent. Une piste pour mon archéologie intérieure.
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même
6 juin 1992
[Journal de bord — Extraits.]
Il y a dix jours de ça, Pascaline qui laisse cette phrase en vol sur le répondeur : « Pas la peine de venir cet après-midi, Sandro est décédé, hier, à Poitiers. »
L’injustice monstre. Pauvre petite adorable esseulée Pascaline : mère poivrote un bon quart putain, demi-frère mort d’overdose, elle-même post-junkie, et une tumeur cancéreuse crispée aux intestins, un accident, il y a deux semaines qui l’a manquée d’un cheveu tellement la tôle a paumé, et son gosse d’un an à peine, presque à sa place, mort dans la prémonition qu’elle avait alors eu de sa propre mort. Sandro, à trois cents kilomètres d’elle, avec son papa tête en l’air, camelot de foire à moitié rêveur à moitié sans imagination, sur le parking où il montait son stand.
Pascaline plus qu’en pleurs, les yeux crevés de larmes, hagarde qui se laisse piéger au café de son beau-frère, repère de la zone des halles. Pascale qui m’écoute mais qui a déjà un pied dans la tombe de son adolescence : héroïne, suicide à petit feu, beuveries sans issue, nuits à arpenter l’asphalte juste pour se prendre le hasard des mauvaises rencontres dans la gueule. Passé tout un dimanche avec elle. Quand il n’y a rien à dire, qu’à soutenir un pont qui lentement s’affaisse, qu’à empêcher le fleuve de revenir à la mer, rien à dire, sinon un contre-courant de mots vains pour passer le temps sans que ça se voie, le temps avant l’enterrement du mercredi qui s’annonce comme un terrible ultimatum. Matinée du mercredi avec elle, en route pour Romainville où elle veut apporter en « main propre » l’acte de décès à G., son employeur municipal et directeur du service jeunesse. Elle est totalement stone. J’essaye pour la énième fois de la convaincre d’aller à l’enterrement pour réaliser la disparition de Sandro. Elle s’arc-boute dans le non. Non. NON.
J’esquive : si tu veux un psychiatre pour les antidépresseurs et ma piaule pour changer d’air. Tout cet amour qui lui revient en boomerang la tétanise. Elle rejette en bloc la tendresse que ses proches lui offrent comme si de ce refus buté dépendait la survie ne serait-ce que mentale de Sacha. Elle ne veut pas d’une aide qui suppose, induit, justifie la mort de son fils. Elle ne veut rien. Il faudra lui donner de force. Petit à petit, une incroyable osmose commence : j’arrive par je ne sais quel détour de ma propre fatigue nerveuse à la faire sourire, puis éclater de rire, en marge de son chagrin. Elle s’évade une seconde, par ci, par là. Rien n’est plus beau que cette souffrance qui s’échappe à elle-même, qui se fait la nique très provisoirement. Puisqu’elle ne veut pas de notre inquiétude, je lui propose une manifestation de deux cents personnes au bas de ses fenêtres avec une banderole : « On est tous inquiets ». Elle pouffe et, d’un coup d’œil tendre : « Yves, tu en serais bien capable… » Ça retombe : « Je sais plus où j’en suis… » Je lui tends un plan de métro en lui assurant que depuis la semaine dernière, la ligne a été rallongée jusqu’à Romainville. La voilà qui glousse de plus belle, et ainsi de suite. Deux heures d’oublis passagers où les nerfs se donnent un coup de main pour abolir l’affreux ultimatum. Je ne sais donner que ça, un peu d’humour à chaud et froid. Un petit don qui rend fier, non pas de soi, mais de la nature humaine, pourrie d’injustice et toujours capable de la déjouer.
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même
18 mai 1992
[Journal de bord — Extraits.]
Dernières surprises de ces deux semaines : mon audacieux larcin aux Archives nationales, le vol très provisoire du « Carnet de route d’un sans-patrie », le journal de voyage de Van der Lubbe, le futur incendiaire du Reichstag en février 1933. J’ai photocopié et remis le texte en place la semaine suivante, mais le jour de l’emprunt abusif, j’ai bien failli finir au poste, vu qu’une fouille surprise des sacs avait été décrétée à la sortie. Fuite aux toilettes. Le manuscrit glissé sous slip et tee-shirt. Ni vu ni connu. L’incendiaire passé en douce des poubelles archivées de l’histoire à ma chambre de bonne où je prépare le scandale d’une hypothétique réhabilitation.
Quant au texte, reproduit dans un canard libertaire breton en 1934, c’est le récit simple, limpide, transparent de l’errance jusqu’à Constantinople d’un jeune prolétaire internationaliste, donc vagabond sans-patrie, trimardeur de l’entraide et colporteur d’idées révolutionnaires. Une merveille dans son écrin, malgré les salissures staliniennes et la chiennerie bien pensante des gauches de l’époque qui ont laissé assassiner ce pauvre idéaliste par les nazis en ne trouvant rien de mieux que de le traiter de « pédéraste » dans le Livre Brun paru à l’époque et signé, contresigné par toute l’intelligentsia « anti-fasciste ». Sans parler de la censure ordinaire des chercheurs qui depuis un demi-siècle n’ont même pas fait l’effort d’en reproduire le moindre extrait.
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même
6 mai 1992
[Journal de bord — Extraits.]
Le soir en public, le jour en circuit fermé.
La pièce commence à faire son effet, bouche-à-oreille et ainsi de suite. Je me fonds dans le jeu collectif comme un motif répété sur du papier peint. Je crois que je n’ai pas encore pris conscience de ce que je faisais, sinon… Hier, François a carrément oublié un des accessoires principaux (la lettre) dans les loges. Chaque soir, il oublie quelque chose de nouveau pour inventer autre chose. Il se pousse à la faute pour s’urger dans la tête une lubie inédite. Vase communicant de l’oubli et de la création.
Bleus partout, écorchures, crampes. Pendant ce temps, l’âme se repose.
Hier, le fils Joppolo de l’auteur de la pièce originel est venu. Il a aimé. On sentait qu’il ne comprenait pas comment un jeune petit inconnu dans mon genre s’était mis à trahir intelligemment l’œuvre de son vieux papa tutélaire. Alors, il a dit que j’avais été fidèle à ma manière. Et il cherchait des choses à dire, mais retombait à chaque fois dans sa généalogie artistique œdipienne : moi, mon père, moi, mon père, moi… et mon père.
Patrick est passé aussi. Un peu maussade ou à demi ravi. Empêché à moitié de se laisser aller à sa loufoquerie naturelle par sa salope de maladie qui le tue à petit feu, qui le fatigue en profondeur. T4 qui descendent, T8 qui remontent. Un jeu vidéo dans les veines. Globules ceci contre anti-globules cela. Il a fallu attendre ce siècle finissant pour s’apercevoir que la véritable science-fiction est dans notre corps et que nos envahisseurs sont là, en nous, depuis la nuit des temps. Petit Patrick, ton envie de vivre qui sait de moins en moins ce qu’elle envie, j’aimerais me fraterniser avec toi pour de bon, renaître ton frère et te prêter l’immunité qu’il faut aux vrais vivants parmi toutes ces silhouettes sociales, soumises, déjà mortes et qui te survivront sans le savoir. Crèvent les autres et reste là.
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même
4 avril 1992
[Journal de bord — Extraits.]
Me voilà condamné à faire le pitre.Après avoir essayé et usé deux actrices dans le rôle du deuxième carabinier, François Wastiaux m’a mis l’ultimatum sous le nez. Pas de spectacle si tu ne joues pas.
D’accord.
Donc, un mois de répétitions forcenées, dix heures par jour à se triturer la mémoire (même si j’ai écrit l’adaptation, les mots me reviennent dans le désordre), à s’assouplir le corps récalcitrant et à garder sur les planches une certaine naïveté non feinte, le plus dur, peut-être.
En tout, quatre comédiens en pleine maturation, plus moi, l’enrôlé in extremis et François W., Homme-orchestre, jubilant inné, farfouilleur d’espace, improvisateur prémédité, mais aussi enfant gâté à ses mauvaises heures, despote impatient et aveugle qui fait broyer aux autres ses trous noirs. Brouillon, sinueux et capricieux jusqu’à l’ultime seconde, François m’a mis dans sa galère, peu à peu, par petites stratégies byzantines jusqu’à m’immerger dans son aventure jusqu’au cou. Si on pouvait jouer sans sa tête, ça doit être ça la concentration : cou coupé.
Je fais donc le malin sur scène, le duponD du vrai duponT, je fais aussi le diplomate dans les moments difficiles, le huileur de rouages encrassés, l’empêcheur de s’étriper en rond, ronds de jambes, rond dans l’eau triste des névroses de fin d’après-midi, rond comme la roue qu’il faut réinventer tous les jours au théâtre.
Au bout du compte, on m’a jugé « naturel » le soir de la première. En vrai, je sors plutôt du texte que je n’y entre. Les autres chiassent à l’avance, tandis que moi je désespère de ressentir ce foutu « trac » viscéral. Je fais ma passe à distance sans arriver à trahir complètement ma petite nature, un peu rigolarde, un peu provo, un peu tâcheronne. Sur la scène, je me sens dépaysé et si un paysage se crée à travers ma présence, c’est tout à fait malgré moi. Magie des lumières, des remous du public, des condensés symboliques d’espace. Tant que ça me dépasse, tant mieux. Seule la perspective de tenir cinq semaines m’effraie un peu. Chaque jour, retrouver une énergie nouvelle. Où ça ?
François m’aide énormément par sa confiance, son évidence en amitié, son phrasé postillonneur, boulimique qui cogne juste et me tire les répliques de la gorge. Parfois, il oublie un déplacement qu’il m’avait lui-même imposé, alors je panique. Je redeviens l’ouvrier minutieux qui prend son patron en faute et qui voudrait gommer cette faute maladroitement. Alors qu’il n’y a pas de faute au théâtre, pas de faux mouvements, que des gestes incomplets ou absolus, que des ombres coupées du corps ou portées par lui au-delà de toute humeur contrôlée. Les autres acteurs, après des mois de doute, commencent à y croire. Même Valérie W., grand angoissé d’origine croate, traquant sa mémoire jusqu’à la catatonie, stressé d’un bout à l’autre de ses un mètre quatre-vingt-dix de nerfs à vif, commence à se plier à son envie de jouer après avoir traversé le vrai désert du métier d’acteur : le gouffre narcissique, l’obsession de « l’image » rendue qu’il aurait voulu gérer jusqu’au bout, calculer parfois mesquinement – « Face public », on dit dans le jargon. Reste une raideur juste quand il veut se donner. Sa maman d’un soir, Valère, aussi dingue que douce, n’arrive pas, elle, à lâcher tout à fait sa voix. Christophe et Stéphanie, plus amateurs, mais si immédiatement généreux, donc déjà au-delà de tout professionnalisme truqueur. Dans une semaine, nous arriverons peut-être à manquer tout à fait de retenue. Moi aussi, dans mon rêve éveillé. Jamais vraiment comédien, mais espérons-le, somnambule convaincant.
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même
4 mars 1992
[Journal de bord — Extraits.]
Hier, déjeuner avec Bernard Wallet. Enfin paisible, disponible, radieux, il me tend le manuscrit achevé de ses souvenirs du Liban : Paysage avec Palmiers.
Ce matin, lente lecture hypnotique.
Puis lettre à l’auteur :
«Chaque fragment porte son « ombre étroite » sur celui d’après. Chapelet qui crée une sorte d’impression de sacré au beau milieu de la désacralisation de tout. La taxidermie sociale de Fénéon appliquée aux beaux-arts du meurtre collectif. Chaque fragment qui dévoile et abolit en même temps un bout de réalité. Plus besoin du « comme si » métaphorique puisque les paysages simultanés qui se libèrent et s’enchaînent sont des paraboles vivantes, des images incomparablement justes, des métaphores peut-être, mais de celles qui n’existent dans la réalité que pour nous faire sortir de toutes nos références, que pour mettre en péril nos assises culturelles. Bombes à fragmentation, donc. Il y a les œuvres de bon goût qui sont condamnées à la fadeur éphémère. Et puis, là, une série d’arrière-goûts qui se succèdent à telle vitesse et densité qu’on ne peut remonter au stade commode du jugement de valeur (ça sent bon, c’est délicieux, etc..), du petit appétit de lecture contemporaine… C’est comme une force dont on ne connaîtra jamais le premier état, spectaculaire ou anecdotique ou politique ou moral… juste l’empreinte que cette force, après implosion, a laissé dans ta Langue. Implosion vraiment, parce qu’on a l’impression que chaque fragment refait à l’intérieur du langage le chemin inverse de ces mille catastrophes morbides. Non pas pour sauver ces morts de l’oubli, mais pour réorganiser leur non-sens inouï autour d’un dernier atome de réalité qui ferait sens ou geste ou signe ou… Du sacré encore et encore, mais ici c’est l’anatomiste qui prononce les oraisons funèbres, qui remet les cadavres dans des trajectoires sensibles (cinq cents “dormeurs du Val” se donnant la main) tout en ayant magnifiquement éludé la tentation du « pathos » qui, dans toutes guerres civiles, travaille en sous-main du côté des pulsions de meurtre. C’est peut-être cela, le plus effrayant, dans ce livre de l’anti-Martyr, un au-delà du “lyrisme” canonique, une juste froideur qui seule peut contenir toute l’émotion à exprimer, qui ne doit jamais céder à l’emportement lyrique sous peine de prendre malgré elle le point de vue même des élans meurtriers. Tout le contraire du journalisme donc, ayant depuis si longtemps pris en otage l’émotion poétique pour la mettre au service de tel ou tel serial killer officiel. Tout le contraire du recueil d’exotismes narcissiques. Absolument tout le contraire. Et je me suis senti incroyablement proche de tes “gisants” retournant l’énergie du meurtre contre leurs assassins à l’aide de ta syntaxe implacable.
Merci pour toutes ces fraternités d’outre-tombe. Sans fleur, ni couronne, rien que des lauriers pourrissant sur la tête des despotes et, pour leurs victimes, les fleurs du pauvre, des bouquets de pissenlits par la racine. »
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même
30 janvier 1992
[Journal de bord — Extraits.]
Envie latente de partir sur une autre piste : écrire, très en pagaille-détail, à partir d’une nuit blanche. Chaos de conversations, vols, rixes, acteurs ivres massacrant par cœur des grands classiques. Débauche verbale. En fait, cela fait des années que ça me démange de tout faire converger là tout un opéra : sur le zinc. Sitôt pris au cœur d’une beuverie, j’ai toujours l’impression que je suis capable d’en venir à bout, de ce désir de transposition. Bourré et porté par le flot des paroles, je crois avoir tout capté de cette dérive. Mais dès le lendemain, ça s’estompe, le sentiment subtil de la durée qui doit tramer l’écriture, c’est déjà du mesquin petit souvenir, mis bout à bout. Impossible de retrouver l’élan de la veille, tout s’est déjà éventé. Reste que cette vieille utopie romanesque, faudra bien que je lui fasse un sort. Surtout, ne pas laisser tomber les idées qui vous remontent régulièrement à la surface, sinon on fait des pleins et des déliés autour du vide. Et on gobe n’importe quelle fausse bonne idée dans l’air du temps.
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même
20 janvier 1992
[Journal de bord — Extraits.]
Double aveugle : acheté hier le dernier bouquin de Nicolas Morel. Premier chapitre presque sublime. Un chômeur qui se réveille à l’imparfait, au présent de l’imparfait plus exactement. Tous ses actes décrits dans un passé de la répétition alterné avec un présent de la conscience immédiate. Du on, du je, du il, les trois en même temps. Détail d’importance : le livre tourne autour de l’idée de cobaye, ce qui flirte intimement avec mon soi-disant prochain roman. L’air du temps. Ça fait un an qu’on doit se rencontrer, Morel & moi. C’est fait.
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même
10 janvier 1992
[Journal de bord — Extraits.]
Souvenir d’il y a une semaine : j’apprends par Eric, le seul ludion franc et massif de l’underground parisienne, qu’une bande de snobs vont annoncer leur ralliement au Parti Communiste Français au Moloco, ignoble bar branché de Pigalles. J’y vais donc pour m’en payer une tranche. Finalement, ils se sont fait refuser à leur grand étonnement par le patron du Moloco. Motif invoqué : risques de descente de fascistes, donc pas de politique dans son Haut-lieu. Repli stratégique sur un bar en face, bar à traves et arabes (à des prix normaux donc). Juste le moment plus hilarant de cette farce : le gérant de L’Idiot International, un certain Marc Cohen (membre et poisson pilote du PCF-branché), avec à côté de lui, un certain Soral, auteur de Les Mouvements de mode expliqués aux parents, superfrimeur venu draguer en eaux troubles. Discours à deux voix. D’un côté, le petit apparatchik en mission prosélyte ; de l’autre, le grand blond, rallié à la cause par dandysme au quatrième degré. Un mètre cinquante d’amnésie stalinienne en compagnie des un mètre quatre-vingt-dix du converti de fraîche date au « marxisme ». À crever de rire. La carpe et le coup du lapin. Le petit juif honteux transi d’admiration pour sa recrue bien aryenne : blabla pour les voitures françaises, les mines de charbons françaises, etc. Le snobissime Soral ose même une apologie d’un nouveau « national-populisme » à la française pour contrecarrer le Front National. Drieu derrière le masque de Malraux qui se prendrait pour un Morand tendance Nizan. Il dit adorer « Céline en littérature », mais préfère « appeler cette première cellule des travailleurs des médias, cellule Vailland ». Je prends vaguement la parole : « Elstine est l’auteur d’un récent putsch stalino-libéral que certains avaient déjà prévu dès les années 1920 au risque du Goulag… en URSS, le capitalisme d’État dévoile son vrai visage, après avoir, il y a quarante ans déjà, dévoilé sa consanguinité avec la tentation fasciste, etc. » Je cause un peu Histoire donc, dans le désert devant une trentaine de petites têtes molles qui me regardent comme si je tombais de la lune. Illettrisme politique absolu. Question : cette scène qui se passe aujourd’hui, est-elle si différente de celles qui ont dû se passer dans les années 30 quand les normaliens s’enrôlaient pour le stalinisme et insultaient Victor serge, Souvarine, Trotsky et tant d’autres sans rien savoir de rien, par anti-conformisme analphabète. Pauvre histoire des idées revues et corrigées par des poseurs cyniques. On se casse avec l’ami Eric qui vend ses journaux satiriques dans les bars. Beuverie au Chat Noir. Une vieille putain m’aguiche. Ex-fantasme obèse, ridé, et qui se confie jusqu’au vertige de l’angoisse, bières après bières. Je rentre me coucher aux aurores.
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même
10 janvier 1992
[Journal de bord — Extraits.]
Retour de mini-vacances à Belle-Île. Mer calme, soleil d’un beau fixe. Tours et détours de l’île peu déflorée par l’obscénité immobilière. Falaises, plages secrètes, grottes, sable immaculé ou presque. Luxe, calme et volupté, quoi ! si ce n’était le terrible ressentiment du violoniste Michel L., litanie enveloppante, brillante et poisseuse à la fois, qui n’a pas cessé de faire écran. Dommage pour lui d’abord qui n’arrive pas à sortir de son trou noir, qui s’accroche à mille rancœurs pour mieux s’enfoncer : guerre d’Algérie omniprésente, remords douloureux qui lui reviennent du fond des djebels insurgés. Côté face, l’ancien combattant, fils de capitaine de bateau, frère d’un raté de l’Indo… Côté pile, le lecteur médusé de Giono et Miller, l’ancien 68-tard, l’ami du situ J.-P. Voyer. Et, comme chez Céline, mais sur son versant breton et dionysiaque surtout, un antimilitarisme d’ancien combattant, c’est-à-dire un monstre hybride de médailles et d’insoumission, un pacifisme au forceps, un gauchisme post-traumatique, pris dans ses contradictions non pas oiseuses, mais des contradictions qui poursuivent la guérilla vécue paradoxalement du mauvais côté, en Algérie (à cinquante mètres d’une salle de torture en l’occurrence) par un tangage moral, politique, éthique, une houle verbeuse amoureuse de son propre naufrage. Et, comme toujours, à l’horizon, un bon abcès antisémite qui purule surtout après minuit quand la bouteille de whisky ne soigne plus les mirages que par d’autres mirages : celui des violonistes juifs coalisés. Une bonne leçon de célinisme appliquée, sauf qu’ici, la haine de la vieille bourgeoisie droitière bretonne le préserve de toute dérive fascisante. Une épure d’antisémitisme donc, à fond de cales, furieux, mais qui sait ce qu’elle est, un défouloir commode, un kyste qui se préserve de toute infection. Si, par malheur, Michel perdait ses doigts, sa compagne et tombait dans la misère qui l’attend au coin du bois, alors personne ne pourrait plus répondre de rien. Le pus sortirait par litres entiers. Il faut laisser les Dieux danser, les fureurs jouer, les phantasmes rendre leur libre son, sinon la part morbide du divin passe à l’acte. C’est fou comme l’ambiguïté de Nietzsche est exemplaire, le cul toujours entre les bacchanales du vin et du sang, de la musique et de l’élite, cette drôle d’impasse qui mène l’artiste à la Kommandantur, et très précisément, la mélodie à la litanie, le rythme au pas cadencé, (comme chez Céline les « bagatelles », les « rigodons » et les « guignols » au « massacre »). Transfert d’énergie, on dit souvent; plutôt un problème de passage à l’acte. Quand l’acte de création, l’Acte d’écrire, d’inventer, de jouer, tous ces actes de pensée ne sont plus considérés comme tels et que seule l’action sous sa forme grégaire, ramenée à sa matrice militaire, est valorisée, alors c’est foutu, toute la force qui s’exprime dans la pensée en mouvement de l’art, transmigre vers les champs de bataille du pouvoir et de la guerre.
C’est dans les livres de Deleuze que j’ai eu l’intuition de ça, de cette transmutation des « pulsions » à partir d’un malentendu : l’action vue sous son angle exclusivement et ostentatoirement physique et massive et ignorée dans sa forme langagière, poétique, onirique et tous les etc. qui s’imposent. Nouveau danger à venir : l’action qui commence à arborer un nouvel emblème, une forme exclusivement juridico-financière. Nouveau brouillage, non plus par le culte militaro-techniciste de la production, mais par le culte, plus aliénant évidemment, de l’action en justice et de l’action des flux monétaires. D’une certaine manière, on a gagné en intelligence, puisque ces nouvelles actions à la mode sont au moins des fictions vraies, certains peuvent donc comprendre que l’acte de parole a autant d’effets que la rixe ethnique, que le combat de rue ou la bataille rangée, mais le drame pour l’art (même le mot commence à puer du bec) d’aujourd’hui c’est qu’il doit se trouver en territoire propre, un champ d’extension hors de ces fictions productives, qu’il n’a plus de place pour exprimer son mentir-vrai (expression géniale du stalino-poète Aragon), pour le distinguer de l’économie des actions fictives rentables. Il était difficile d’expliquer un acte gratuit à Goebbels, c’est peut-être encore plus difficile de le revendiquer de nos jours, maintenant que les apprentis-Goebbels du Capital-flottant ont résorbé en eux toute l’abstraction créative. Le Verbe déplace des montagnes, mais dans son Plan d’Occupation des Sols, il n’y a plus de friches, de jachères, de nouvelles frontières, de cases vides, de mers mortes. D’où le devenir-squatteur des peintres à Paris, par exemple, devenir lui-même récupéré dans un nouveau cycle de spéculations immobilières, et ainsi de suite. La parole est à reprendre, mais tous ses lieux sont piégés… reste une parole qui aurait déjà son territoire à l’intérieur d’elle-même ?
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même