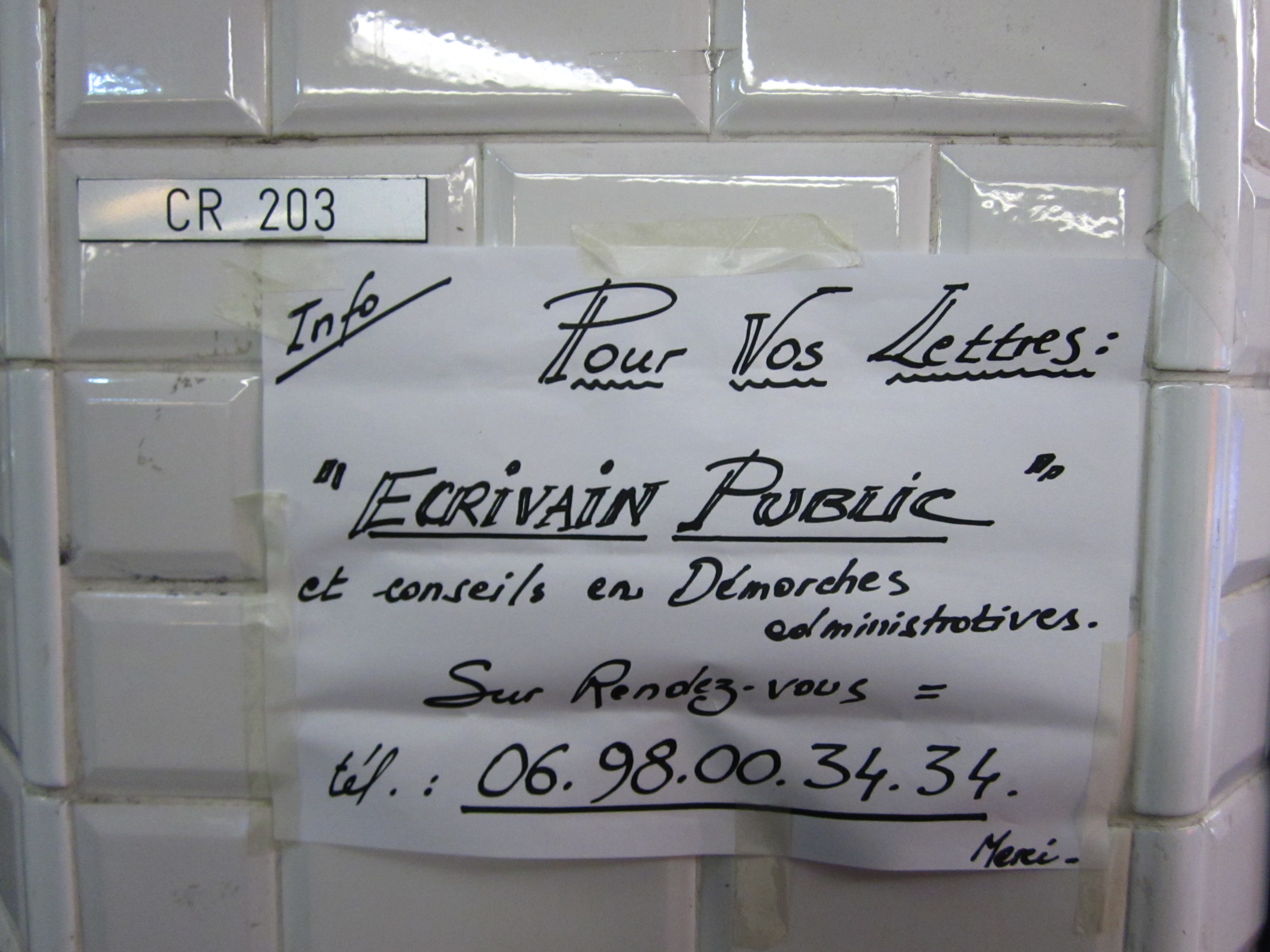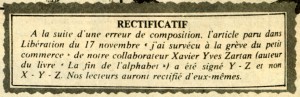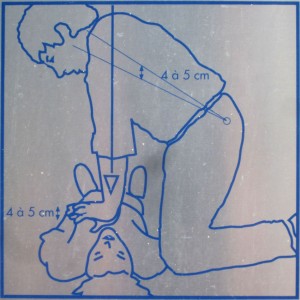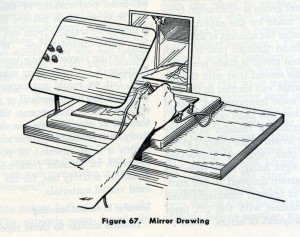7 juillet 2010
[Lendemains de fête — Oraison pas funèbre.]
La semaine dernière, aux Subsistances de Lyon, François Beaune fêtait la première du Majestic Louche Palace, pot-pourri bordélique réinventant son premier roman, Un homme louche, sous forme de cabaret.

D’ordinaire, je préfère éviter le blabla promotionnel de pure copinage pour les écrivains qui émargent chez Verticales. Sauf dans certains cas extrêmes… comme la disparition dudit auteur.
Mais là, c’est pas le cas, plus vivant que jamais, mais justement, c’est lui qui m’a forcé à rédiger un petit éloge posthume du personnage principal de son bouquin, Jean-Daniel Dugommier, décédé il y a deux ans à peine. Pour commémorer l’anniversaire plausible de la mort officielle d’un inconnu fictif, j’ai passé outre mes scrupules et fini par m’exécuter. En alexandrin, au tout début, et puis j’ai changé d’idée parce que c’est pas si facile, douze pieds, quand on n’a que cinq doigts à chaque main.
Le texte, intégralement revu et corrigé par Word 2004 pour Mac, ici même.
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même
2 juillet 2010
[Texticules et icôneries — Prière de ne pas… s’immoler.]

Vœux pieux ou vieux pneus…? Mystère & boules de gomme.
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même
29 juin 2010
[Commémoration à reculons — D’un Debord l’autre.]
Il y a tout juste un an, la Bibliothèque Nationale organisait un dîner de gala, à 600 euros le couvert, pour rembourser les frais d’acquisition des manuscrits de feu Guy Debord. S’y pressait le Tout-Paris de n’importe quel défilé de Haute-Couture : pontifs demi-mondains de l’ex-gauche caviar & zazous faisandés de la droite néo-hussarde, parmi un vaste échantillon de jeunes écervelées à particule. Comme si le situ suscité ne pouvait décidément plus échapper aux caricatures posthumes de sa théorie, ici réduite à sa plus simpliste expression : cette risible photo de famille de la « société spectaculaire intégrée ».

Et pourtant, ni regrets amers ni larmes de crocodile, tant pis si ces festivités patrimoniales font se retourner dans sa tombe le mort en question, il l’a bien cherché – lui qui n’en finissait plus de rédiger son propre «panégyrique» depuis les années 90. Ironie du sort, ses plus zélés disciples d’aujourd’hui semblent n’avoir retenu de l’aventure collective situationniste – dont, rappelons-le, Guy D. n’incarnait qu’une facette parmi d’autres – que le soleil noir d’un catastrophisme tous azimuts, ou pire encore l’élitisme artisto d’un surplomb moralisateur.
On a les Judas qu’on mérite… mais comme, parmi eux, il paraît que le vulgarisateur Philippe Murray se distingue – avec le profil néo-réac de l’emploi médiatique –, faudrait faire gaffe à ne pas confondre pensée critique et ressentiment compulsif, bref se méfier plus que jamais des contre-façons culturelles…
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même
26 juin 2010
[Portraits crachés — Suite sans fin.]
Odette, fille désespérément unique, a beaucoup attendu avant de trouver l’âme sœur dans la banlieue pavillonnaire de Chateauroux. Et puis c’est arrivé, en fin d’après-midi, d’un seul coup de sonnette, peu avant sa majorité, un homme d’âge mûr sur le pas de la porte qui lui a parlé des origines extrahumaines de toutes choses, qui lui a ouvert les yeux sur le bonheur immortel d’aimer autrui plus que soi-même, qui lui a décrit le septième ciel et les pires entrailles de la terre à l’aide d’un petit livre illustré, qui lui a serré délicatement la main sans chercher à profiter d’elle, qui lui a promis de revenir le prochain vendredi et qui a tenu parole chaque fin de semaine pendant deux longues années, sans jamais quitter le seuil de leur complicité naissante ni pénétrer plus avant le jardin secret de cette adolescente. En songes inavouables, elle a bien dû l’imaginer en prince charmant, soudain rajeuni de vingt ans, et espérer qu’il lui concède un regard malséant ou un geste déplacé, ne serait-ce qu’une fois, par simple mégarde ou éphémère curiosité, mais non, il n’a jamais goûté à ce fruit défendu. Et l’inébranlable désintéressement du visiteur hebdomadaire a fini par forcer son respect, apaiser les humeurs mouvantes de son âge et la conquérir tout entière.
Depuis que ce disciple de Jéhovah lui a passé le témoin, Odette s’est vouée corps et âme à la même démarche, colporter des versions abrégées de la bible auprès des pauvres dévoyés et des riches païens, exclus d’office du Paradis qui ne va plus tarder à reprendre son empire ici-bas, dès que les faux cultes des croyants et les singeries du darwinisme auront laissé place nette à une espèce vraiment humaine. Pour subvenir aux besoins de la Cause, la jeune infirmière diplômée, rebaptisée Evita par ses coreligionnaires, a rejoint la capitale. Elle a d’abord exercé à plein-temps dans un service de grands brûlés – ces preuves vivantes d’une apocalypse imminente –, tout en allant visiter au crépuscule les habitants des HLM de la banlieue rouge – Clichy, puis Romainville, puis Pantin, ses premières terres de mission. Par horreur du sang transfusé et souci de préserver du temps pour ses œuvres spirituelles, elle a donné sa démission et trouvé une place de concierge dans les beaux quartiers. Ici, chacun apprécie cette charmante gardienne, attentive, serviable et d’une discrétion exemplaire.
Pour conjurer la drame fratricide de l’ex-Yougoslavie, elle œuvre plutôt à distance, toujours pendue au bout du fil dans sa loge, à force de nouer des contacts avec ces populations martyres. Son mouvement lui a fourni les annuaires du cru, à elle d’appeler par ordre alphabétique en se repérant sur des cartes routières. C’est une occupation très onéreuse, mais hors le peu qu’elle s’octroie pour vivre, c’est sa façon de payer de sa personne pour précipiter le retour du Paradis sur terre. Pour ce faire, elle a dû s’initier par correspondance aux rudiments du serbo-croate, et même de plusieurs langues salves, puisque, au-delà des Balkans, Evita a aussi pris langue avec des arméniens rescapés d’un tremblement de terre, des irradiés ukrainiens et d’autres minorités chrétiennes de l’ex-Empire soviétique.
Et ce ne fut pas une mince affaire, pour cette Bretonne de souche ne parlant pas un traître mot d’anglais, que de savoir désormais citer une dizaine d’extraits des Ecritures dans la plupart des idiomes de l’Europe de l’Est. Mais s’il faut voir en chaque miracle une sorte de malentendu contagieux, en voilà un qui se répète chaque matin aux aurores, sur les berges du canal de l’Ourcq ou vers la gare routière de la porte de Bagnolet, quand cette illuminée polyglotte, un thermos de café chaud à la main, entame la conversation avec quelques réfugiés d’outre-tombe.
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même
23 juin 2010
[Lendemain de fête — Archyves in situ.]
Le samedi 19 juin, au théâtre de L’Aire libre, à Saint-Jacques-de-la-Lande, tout près de Rennes, Benoît Bradel organisait le micro-festival Parcours, soit 9 formats courts de Anne-James Chaton & , Andy Moor, Loïc Touzé & Ondine Cloez, Yan Duyvendrak, Gaspard Delanoë & Gaëlle Bourges, la compagnie Grand Magasin, etc. À l’affiche, des propositions multipistes entre danse, vidéo, post-rock, performance ou théâtre…
Et l’occasion pour François Wastiaux & moi de rejouer notre vraie-fausse conférence de management, Pouvoir Point…

Un sacré foutu speech rétroprojectif dont on peut voir des extraits,
textuels ou visuels, ici même.
Et dans le bar du même théâtre, en première exclusivité mondiale,
une exposition in situ de mes expériences photographiques…


Et grâce au précieux concours de l’ami Philippe Bretelle,
le tirage sur affiche extra-large des Serial Poster qui se cachent…
quelque part sur ce site.
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même
21 juin 2010
[Portraits crachés — Suite sans fin.]
Dans la famille Lamour, je demande la fille : Jennifer. Ce n’est pas une blague de fin de repas, elle existe vraiment cette adolescente née dans une ville moyenne de l’Est de la France, baptisée il y a dix-sept ans Jennifer Lamour, au hasard d’un foutu lapsus parental. Et en guise de doudou, dès la naissance, ce calembour idiomatique qui fait l’amour sans le faire exprès, un premier jouet de mots, sex toy en anglais. Ensuite, il a fallu qu’elle grandisse avec ce nom à rallonge, qu’elle fasse la sourde oreille aux allusions touche-pipi des gamins de son âge, puis aux sous-entendus graveleux entre habitués du Bar tabac de son père. Au collège, sitôt les premiers reliefs apparus sous son T-shirt, ça lui collait déjà à la peau, de sales rumeurs à son sujet : rien dans la tête, tout entre les jambes. Alors, plutôt que de faire la moue, la gourde ou la timorée, au lendemain de ses quatorze ans, elle a pris les devants, relevé le défi, provoqué son destin, pour être enfin à la hauteur d’une réputation précoce : salope tous azimuts. Et elle y a pris goût, rien qu’à voir la morgue virile de ses pires insulteurs se dégonfler entre ses doigts, ses lèvres, ses cuisses. D’un autre côté, ça lui a moins réussi, sales notes en classe, redoublement proposé, passage en CAP filière «couture flou» et abandon en milieu d’année, après cinq mois de grossesse clandestine.
Un an plus tôt, elle avait bien prévenu la conseillère d’orientation : «Si je trouve pas à déboucher dans la mode, je pourrais toujours me mettre en cloque.»
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même
16 juin 2010
[Portraits crachés — Suite sans fin.]
Amélie portait des lunettes bien avant les premiers signes de sa puberté, autant dire la nuit des temps. Au collège, des binocles en écaille sur chaque photo de classe, puis des lentilles jetables l’année du Bac, puis des montures à nouveau, à cause d’une allergie oculaire qui asséchait ses larmes. Une quinzaine d’années plus tard, devenue correctrice hebdomadaire pour la presse féminine, elle a pris rendez-vous chez un chirurgien ophtalmologiste, affaire conclue contre un mois de salaire, à ses frais, faute de mutuelle. Le spécialiste l’a rassurées d’emblée : pour la myopie, l’opération est désormais bénigne, quatre impacts au laser sur le premier œil, puis idem sur l’autre deux semaine après, sans oublier quelques jours de délais avant de s’exposer en plein jour.
Bénigne donc, sauf que pas tout à fait. Une fois rendue à la netteté flagrante des taches d’humidité dans sa cuisine, du tapis rouge effiloché en descendant l’escalier, des auréoles des chewing-gum sur le trottoir, des visages boursouflés d’un clochard à l’entrée du métro, de l’encart publicitaire pour un protège-slip sur le quai d’en face, Amélie a rappelé le chirurgien, obtenu un quart d’heure d’entretien en toute urgence, confié son trouble – ou plutôt le contraire, enfin comment dire, la gêne insupportable causée par cette soudaine absence de trouble – et supplié, trépigné, exigé qu’on fasse quelque chose, parce qu’en démocratie on a bien le droit de changer d’avis, non ? Sauf qu’en l’état actuel de la médecine, l’opération inverse est inimaginable. Faudra qu’Amélie s’y fasse, au plus près des horreurs de ce bas monde, elle ne retrouvera jamais le charme distancié de sa vue antérieure.
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même
4 juin 2010
[Commémoration à reculons —
L’éco-pub de Voynet à Montreuil, mythe et réalités.
Fin du jour de dépôt collectif des encombrants
culpabilisation individuelle des habitants.]
Il y a tout juste un an, la municipalité de Montreuil – Dominique Voynet en tête – supprimait le «jour des monstres». Jusque-là, chaque premier lundi ou mardi du mois, les habitants étaient autorisés à déposer en bas de chez eux les objets dont ils n’avaient plus l’utilité : du dé à coudre à l’armoire branlante parmi un vrac de pièces détachées, bouts de bois, armatures rouillées… Le lendemain, aux aurores, la mairie organisait un ramassage systématique, et à midi tapante, il n’y paraissait plus rien. Pour les lève-tard du coin, cela tenait presque du mirage, ce trottoir qu’ils avaient vu se joncher la veille de bric & de broc, et là, sous leurs yeux à peine entrouverts, au même endroit : place nette.
La nuit portant conseil, quelque sommeil paradoxal avait dû faire le ménage, bon débarras.
En fait, c’est une noria de camionnettes de la voirie, ou de sous-traitants privés, qui s’était chargés d’acheminer et répartir la plupart des affaires restantes à la déchetterie. Sauf qu’en général il n’en restait plus tant que ça, du bordel, sur la voie publique, quand les nettoyeurs se pointaient à l’heure du laitier. Entre-temps, le grand déballage s’était au trois quarts résorbé non par l’opération du Saint Esprit, ni une génération spontanée de matières biodégradables. Juste parce tout le monde alentour connaissait ce rendez-vous du premier lundi mensuel, un marché à la belle étoile dont les étals improvisés se dévalisaient à mesure. Et la tradition voulait que ce même bazar gratuit batte son plein douze fois par an.
S’y côtoyaient proprios de zone pavillonnaire, locataires à loyers modérés, chineurs plus ou moins friqués, retraités bricoleurs, brocanteurs avisés, ex-étudiants précaires, glaneurs romanos, squatters, clochards… Nulle déclaration d’intention liminaire, aucun sponsor officiel, c’était devenu le lieu aussi exemplaire qu’informel d’une économie non-marchande. Mieux qu’un troc amical ou n’importe quel échange de bons procédés entre voisins, c’était un vide-grenier protégé de toute exclusive sociale par l’heureux effet des ténèbres : une multitude de vagues silhouettes rendues à leur anonymat. Et la preuve qu’un rapport désintéressé peut exister entre inconnus, sans arrière-pensée monétaire ou supplément d’âme caritatif. La mise en pratique de vieilles utopies partageuses : «Pas besoin d’avoir les moyens, à chacun selon ses besoins». Autrement dit, « la prise au tas », une manière plutôt fastoche de mettre en commun nos richesses. Mais gare au communisme primitif… trop près de chez vous.
Arrêté municipal oblige, cette expérience d’entraide sauvage est devenue hors-la-loi. Désormais, on doit appeler au téléphone le service des encombrants, quantifier et nommer ses surplus et prendre date, parfois une semaine à l’avance, pour se les faire enlever. Et le moindre contrevenant aux espaces, volumes et horaires annoncés sera dûment verbalisé. Après tout, s’il ne sait plus quoi faire de ses déchets polluants, il n’a qu’à prendre sa bagnole électrique pour rejoindre une décharge autorisée. Quant aux récalcitrants sans roue ni moteur… qui les empêche de porter à dos d’âne leurs ballots de fringues et mobiliers dépareillés chez Neptune ou Emmaüs? Ces professionnels des Bonnes Œuvres qui, eux, savent distinguer les pauvres méritants de leurs faux frères paresseux ou chapardeurs.
Douze mois plus tard, à tête reposée, on se demande encore le pourquoi du comment de cette mesure. Réduction budgétaire ? c’était un des motifs évoqués. D’après certaines indiscrétions, ça serait plutôt le contraire. Parce que, bien évidemment, les dépôts d’ordures tous calibres ont fait des petits… n’importe où et n’importe quand. Moins de monde pour récupérer l’essentiel avant les bennes. Du coup, ça traîne des semaines entières et ça fait tache dans le décor urbain. À tel point que les autorités locales ont cru bon de lancer le mois dernier une campagne d’affichage très grand format, sans lésiner cette fois sur la dépense.

Eco-pub tapageuse qui a trôné quelques semaines à l’endroit même de son apocalypse ordurière annoncée. Avis aux moutons noirs, mal-léchés et peu ragoûtant des alentours, on vous a mis en abyme. Avec une top-modèle de grand marque qui nous tourne le dos pour mieux nous obliger, nous les fauteurs de trouble à faire le ménage dans nos mauvaises consciences.

Derrière cette vision d’horreur, on devine l’argument projectif : une société malade de ses déchets. On aimerait tant abonder dans le sens de tels engagements : l’écologie politique. Mais justement, l’ancien calendrier des encombrants évitait bien du gâchis et, à rebours d’une logique productiviste, vouait chaque produit à durer plus longtemps, connaître plusieurs vies, en changeant de main et d’utilisateur. Au petit bonheur la chance de ces Monstres, plein de choses a priori jetables retrouvaient leur valeur d’usage, jusqu’au recyclage final des moindres matériaux par les chiffonniers et ferrailleurs tziganes. Mais non, même ce tri sélectif autogéré n’a pas eu l’heure de plaire aux édiles municipaux. Du coup, la contre-publicité officiel n’en paraît que plus obscène. Jouant sur l’apeurement de tous et la culpabilisation de chacun, selon un credo très dans l’air du temps – de la Sécu à Pôle Emploi. Brandir le péril ordurier des envahisseurs, c’est jouer avec l’inconscient phobique des électeurs. Surtout quand le reste du message sous-entend que c’est la faute à « tous ensemble »… alors qu’on a bêtement supprimé un système de collecte interactive où s’improvisait une certaine entraide sociale pour le remplacer par un système d’individua-lisation au cas par cas qui délaisse chacun chez soi… dans sa merde.
Post-Scriptum 1 : Si ce billet d’humeur souligne les contradictions gestionnaires et idéologiques de l’équipe municipale en place, c’est sans nostalgie pour l’ex-majorité de l’autocrate clientéliste Jean-Pierre Brard qui préfère noircir le tableau poujadiste en dénonçant la «saleté de la ville».
Post-Scriptum 2 : Il y a un an, les résidents de la Demi-Lune, une maison occupée du quartier de La Boissière, avait placardé une belle affiche manuscrite à propos de ces Monstres en voie d’extinction, à voir ici ou là aussi et même au pochoir ailleurs.
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même
2 juin 2010
[Bribes d’auteurs posthumes — Fin des émissions.]
À la demande de La Maison des écrivains et l’Institut National de l’Audiovisuel, je me suis livré ce mercredi au Petit Palais à un drôle d’exercice oratoire : commenter le prestation télévisuelle d’un illustre écrivain – en l’occurrence Witold Gombrowicz auquel une émission de l’ORTF, la Bibliothèque de Poche, consacra 56 minutes inoubliables, le 12 octobre 1969, en présence de l’éditeur Dominique de Roux et du journaliste Michel Polac.

Pour lire le texte de mon intervention, c’est ici.
Pour entrevoir les images en question, c’est là.
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même
21 mai 2010
[Avis aux amateurs — Seventies not dead !]
Le jeudi 3 juin à 18h30 à l’Université ouverte de la coordination des intermittents et précaires [14 quai de charente métro Corentin Cariou] avec projection du documentaire Guy and Co – film et scénario de Lionel Soukaz, d’après une idée de René Schérer : Cinq jeunes gens réincarnent Guy Hocquenghem, fondateur du Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR) qui, toute sa vie, a refusé de s’identifier à un unique rôle. Le partage d’une soupe ou autres victuailles conclura la soirée (prix libre).
À propos du même Guy H., quelques textes épuisés en ligne ici même.
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même