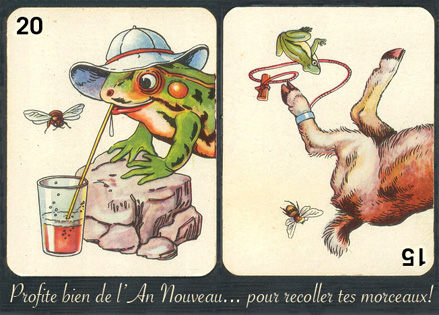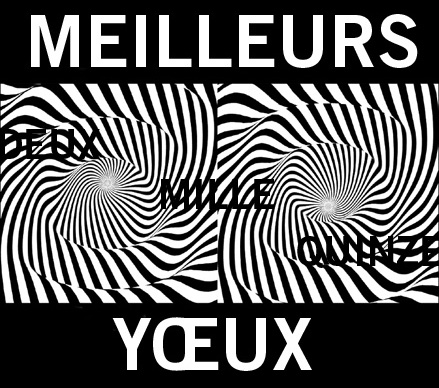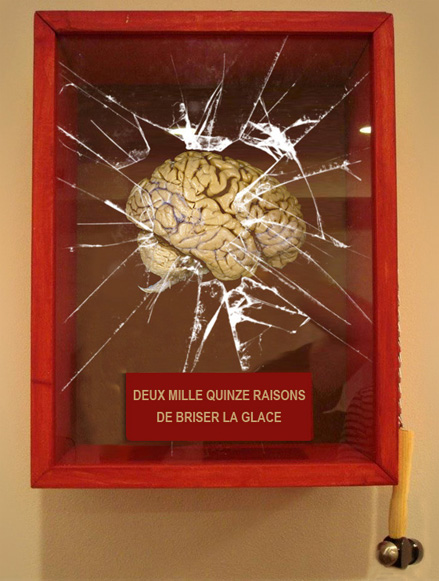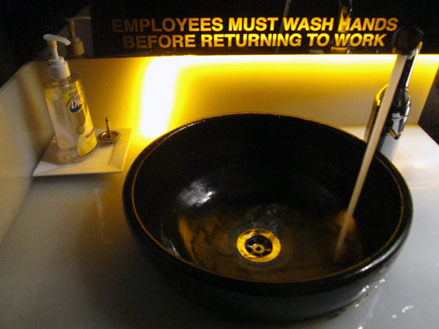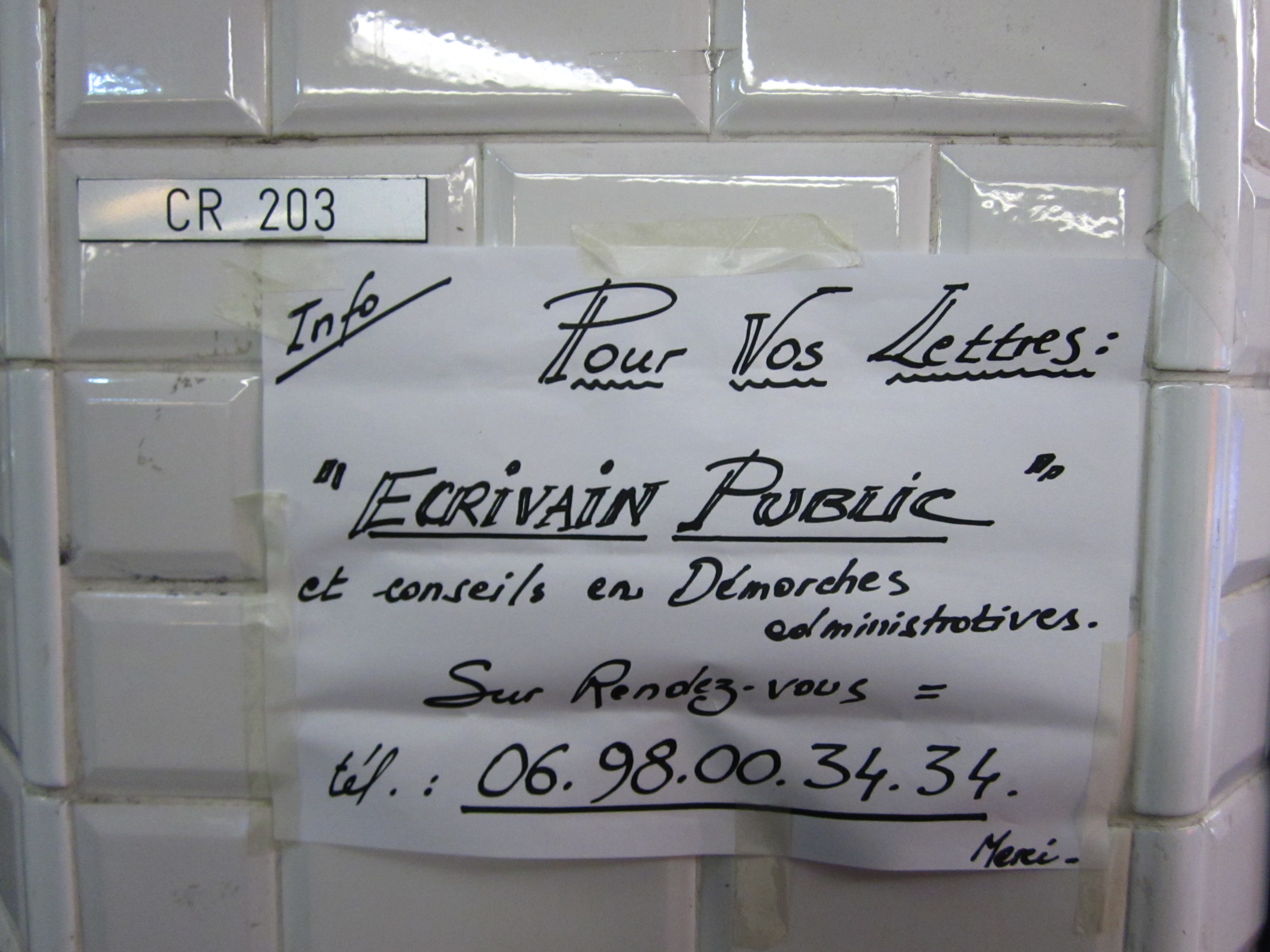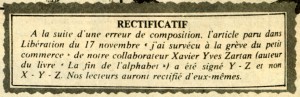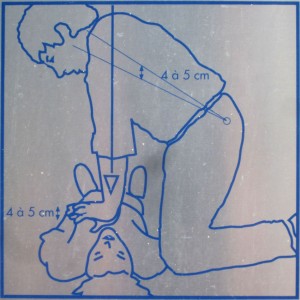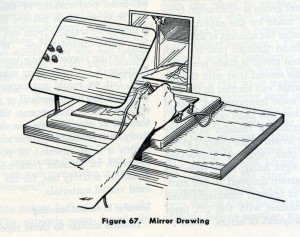De ne pas oublier que près des deux tiers des migraineux ne sont pas conscients de l’être, incapables de mettre un nom sur la gêne latente qui, par intermittence, leur parasite la vie d’une façon, comment dire, sourdement indéterminée.
De ne pas oublier que ma première dissertation de philosophie en hypokhâgne, censée commenter le fameux adage «Qui ne dit mot consent», me valut des pages entières biffées d’un trait rouge et ce jugement professoral dans la marge : logomachie, mot encore étranger à mon vocabulaire dont j’allais porter fièrement l’opprobre jusqu’à la fin de l’année.
De ne pas oublier ce bal du 14 juillet, dans la cour d’une caserne de pompiers où, essuyant des regards tantôt compatissants tantôt excédés, je m’étais frayé un passage sur la piste de danse avec une canne de jeune handicapé nanti d’une patte folle, imposture de mauvais goût visant à séduire Géraldine, à moins que ce ne soit elle qui, contre la promesse d’un baiser, m’ait mis au défi de contrefaire ainsi le boiteux en public.
De ne pas oublier que mon père avait pour chaque bouquet d’herbe folle, la moindre fleur des champs ou tel arbuste poussant au bord d’une décharge publique le don de baptiser ladite plante de trois manières différentes – d’après son nom d’usage vulgaire, d’après son appellation savante horticole et enfin d’après sa racine en langue morte latine –, ce qui rallongeait d’autant l’heure d’en finir avec ces interminables promenades champêtres.
De ne pas oublier que, invité par un adepte de la Scientologie à évaluer l’état de ma psyché, j’avais accepté de le suivre dans une spacieuse boutique du quartier Latin, puis de cocher OUI ou NON aux dizaines de questions d’un QCM standard, avant d’enserrer les poignées d’un galvanomètre pour évaluer mon stress, anormalement élevé sur l’écran de contrôle, le moment ou jamais d’arrêter mon reportage en milieu sectaire, à moins que, histoire de valider son diagnostic, je préfère jouer le jeu au-delà de ses espérances, en m’effondrant par terre, bave aux lèvres, sans connaissance.
De ne pas oublier que l’examinatrice de mon oral du bac français, recroisée deux ans plus tard, allait me soumettre à un autre genre d’épreuve dans l’intimité de sa chambre à coucher : lui lire à voix haute les premières pages de Ma Mère de Georges Bataille avant de passer aux travaux pratiques sous son intimidante autorité.
De ne pas oublier que la voisine de ma grand-mère, institutrice en arrêt maladie perpétuelle, qui, sans doute pour se rajeunir, teintait régulièrement ses cheveux à l’henné avant d’aller faire sa sieste, se réveillait avec des airs de sorcière safranée et un motif supplémentaire de fuir la compagnie de ces « sales gosses tout juste bons à vous empoisonner l’existence ».
De ne pas oublier que Tonio, le plus indolent de mes camarades de lycée, un grand brun avec des chaussettes dépareillées, se plaisait à consigner par écrit ses rêves érotiques, journal d’intimité nocturne qui, confondu avec d’autres cahiers traînant sur sa table, fit le tour de la classe, nourrissant nos pires sarcasmes puis, au fil des pages, un zeste de jalouse admiration.