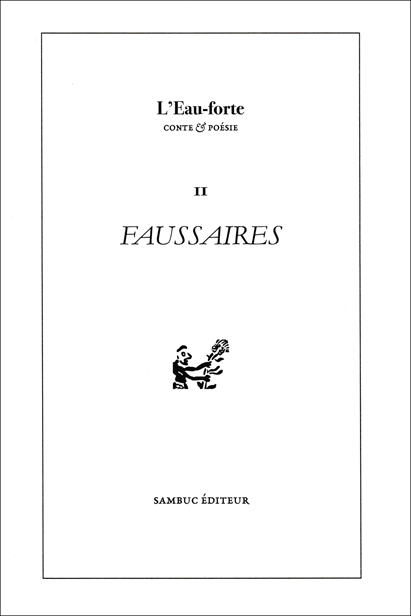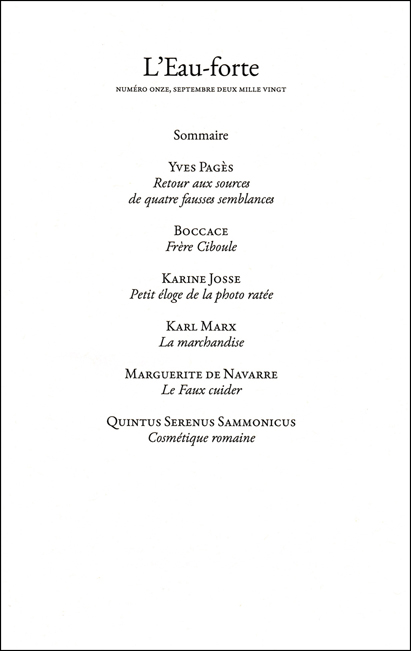5 novembre 2020
[Retour aux sources
de quatre fausses semblances.
Pour la revue L’Eau-forte.]
« Fausse commune », la correctrice de chez Julliard avait rectifié à plusieurs reprises cette coquille dans la série testamentaire qui ouvrait mon troisième roman Plutôt que rien. En cette fausse « fosse » gisait le commun de ces innombrables soldats inconnus fauchés par une balle perdue lors de la guerre de 14-18, où le narrateur cherchait en vain le corps de son père, un messager colombophile mort pour rien dans les tranchées. L’aurais-je fait exprès, je n’aurais pu inventer meilleur lapsus.
***
Fouinant dans les archives du Musée de la police, il y a une trentaine d’années, sur les traces du cordonnier « tueur de flics » Jean-Jacques Liabeuf, guillotiné en juillet 1910, ainsi que sur celles du « déménageur à la cloche de bois » Georges Cochon, leader de l’Union syndicale des locataires depuis février 1911, j’avais recopié dans mes carnets cet extrait d’un rapport de janvier 1912, émanant d’un service dédié à la surveillance des milieux révolutionnaires :
« Plus de 300 anarchistes ont été, en une période de 4 ans, arrêtés, condamnés ou simplement impliqués dans des affaires de droit commun, [phénomène] dû au nombre élevé de poursuite pour fabrication et émission de fausse monnaie, devenu l’un des passe-temps des illégalistes. Il n’y a rien là qui doive étonner, si l’on retient que tout compagnon déterminé trouve dans des opuscules mis à sa portée, voire même dans les journaux de propagande, des formules aussi diverses qu’ingénieuses pour ce faire. »
Dans cette note confidentielle apparaissant soudain, tandis que la « bande à Bonnot » défrayait la chronique d’une Belle Époque libertaire avec ses hold-up en automobile, la part insoupçonnée d’un autre travail de sape qui, à bas bruit, occupait ces marges subversives : une planche de salut immédiat, celle des faux-billets.
***
De tous les poèmes tôt effeuillés en douce ou ânonnés les mains dans le dos sur une estrade scolaire, La Chanson du mal-aimé doit être le seul dont je connaisse encore plusieurs strophes par cœur. Pourquoi a-t-il fait exception, déjoué mes réflexes vitaux d’amnésie ? Qu’est-ce qui n’a décidément pas pu s’oublier en cette filature éperdue d’Apollinaire, « un soir de demi-brume à Londres », à la recherche d’une muse absente, prise tour à tour pour un « mauvais garçon / qui sifflotait main dans les poches », puis « une femme (…) au regard d’inhumaine » ? La pièce manquante de l’amour avec un grand A ? Ou le miroitement trompeur de toute équivoque, prise au pied de la lettre ? En 1898, quinze ans avant la parution dudit poème dans le recueil Alcools, le psychiatre E. Bernard-Leroy avait conceptualisé ce phénomène, « l’illusion de fausse reconnaissance », à partir d’un certain nombre de cas cliniques atteints d’hystérie, d’épilepsie, de neurasthénie, de paramnésie ou d’un sentiment de « double-vie ».
Nomenclature pathologique datée, certes, mais qui traque dans ses manifestations les plus aigues tant d’errements consubstantiels à nos existences, bévues, méprises, impairs tramant nos folies infra-ordinaires. Et pour ce qui touche à la « fausseté (…) même » du dilemme amoureux, ces quelques vers retenus d’affilée me lient à tout jamais aux désirs fluctuants de mon adolescence – aimantés par le « regard » ambigu de tel « voyou » ou la « cicatrice au cou nu » de sa sosie androgyne –, ce qu’on nommerait plutôt aujourd’hui, loin de toutes injonctions identitaires, des « troubles dans le genre ».
***
Peu après que mon père soit parti en fumée, puis mis en urne, mais jamais dispersé nulle part contrairement à ses vœux insistants, juste entreposé dans un casier parmi les allées quadrillant les sous-sols du Columbarium du Père-Lachaise, je me suis suis perdu dans un autre dédale : l’appartement du défunt, enseveli sous des tonnes de paperasses depuis la mort de ma mère. J’ai mis plus de six mois à venir au bout de ce legs encombrant en accomplissant mon devoir filial : trier parmi le fatras d’un vieil intellectuel clochardisé la moindre feuille volante manuscrite qui irait reposer dans les archives d’une bibliothèque universitaire dédié à la psycho-sociologie – une discipline dont il fut un pionnier après l’Occupation –, et jeté une centaine de sacs poubelles pour me débarrasser du reste. Une fois vidés les couloirs, la chambre à coucher et le living-room, restait son bureau, érigé d’empilements instables qui m’arrivaient aux épaules. Et là, m’attendaient sur une étagère d’angle, dans un recoin d’abord masqué par un abat-jour en toile de jute marronnasse, une dizaine de bouquins en rang d’oignons, facilement repérables puisque c’était les miens isolés entre deux serre-livres, dont Le Théoriste, mon dernier roman paru de son vivant, où il s’était senti trahi par le portrait transposé d’un mandarin de l’éthologie dont le propre fils découvrait lui avoir servi de cobaye. ??? Que ce livre-là lui soit resté en travers de la gorge, en plus de son cancer, quoi de plu naturel. Maintenant qu’il n’était plus de ce monde, il y avait prescription. Et comme feu mon père ne parcourait jamais une page imprimée sans souligner, biffer, commenter certains passages, j’allais pouvoir me relire à travers ses yeux. L’ouvrage était bien surligné de grands traits horizontaux au crayon mine, avec des points d’interrogations, d’exclamation ou de suspension ci-contre, mais à y regarder de plus près, il y avait aussi de minuscules annotations dans les marges, non pas des bribes de phrase, même d’un style télégraphique, juste les rognures d’un seul mot, toujours le même épinglant tel ou tel passage : fx. Et cette concrétion de son cru, sale petite idée fixe ayant fait des petits d’une page l’autre, fx après fx, c’était que, faute d’avoir écrit sous sa dictée, j’avais presque tout faux. Indigne tromperie d’un rejeton faussant l’objective supervision paternelle. A ses yeux de scientiste incurable, une véridique fiction devait se rectifier mot à mot, et là, comme il était par définition même le mieux placé pour se savoir, l’unique source fiable, l’univoque point de vue en personne, le spectre de mon prisme imaginaire, c’était zéro sur vain.
Encore merci au duo fondateur de cette revue :
Karine Josse & Raphaël Deuff.
Lien pour partager l’article : c’est juste là.
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même