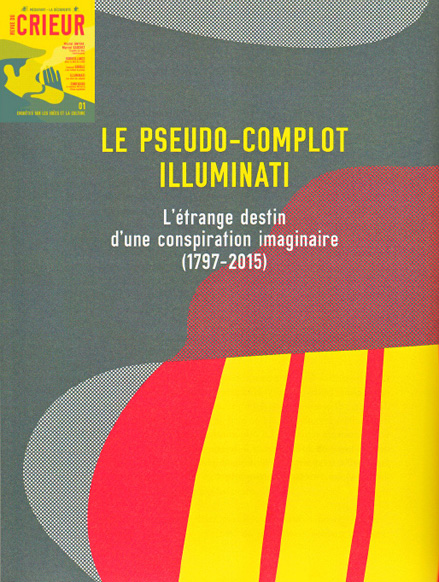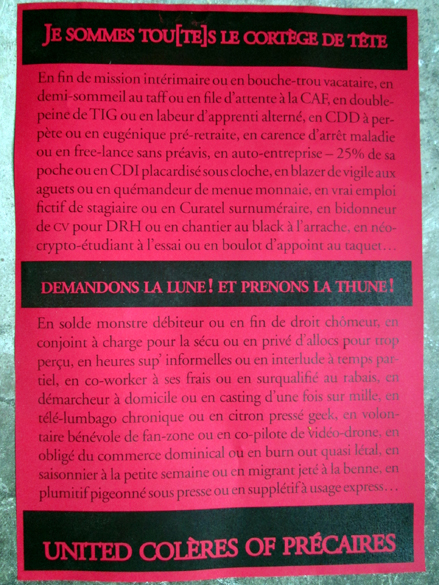3 janvier 2017
[Mieux vœux tard que jamais —
Quelques oublis de l’An passé ?]
Grand blanc sur ce blog depuis l’été dernier. Et pour cause, on avait la tête à d’autres chantiers : une collecte de graffiti (Tiens, ils ont repeint ?! – 50 ans d’aphorismes urbains, à paraître aux éditions La Découverte fin 2017) et un roman au long cours qui m’occupe le cortex à mi-temps (pour les éditions de l’Olivier, disons plutôt, en 2018).
Histoire de conjurer ce silence à rebours, on signalera deux trois ajouts passés inaperçus sur ce blog.
Primo, le texte sur le «Peusdo-complot des Illuminati», paru dans le premier numéro du Crieur, dont on trouvera l’intégralité en format .Pdf ici-même.
Deuzio, un tract de mon cru qui a circulé durant le mouvement contre la Loi « Travaille! » et son monde, intitulé «Je sommes tou[te]s le cortège de tête», dont on trouvera copie dans ces parages.
Tertio, un texte de commande pour les 20 ans du prix Wepler à laquelle j’ai répondu au pied de la lettre en deux pages auto-fictives ainsi chapeautées : «20 ans sans les poussières». On pourra en lire un extrait ci-dessous ou l’intégrale prose sur pdf dans ce coin-ci.
Avoir vingt ans ça n’arrive qu’une fois dans la vie. On s’en voudrait d’en sous-estimer l’importance, d’en négliger la portée spirituelle, d’oublier une date si charnière. Dans mon cas, j’ai commencé à m’y préparer de longue date, dès mon seizième anniversaire. Quatre ans devant soi pour se peaufiner un caractère audacieux et abrasif, bref délibérément inoubliable, un profil sans trace d’acné parasite ni poils au menton, un portrait-robot assez recherché et encore fugitif de jeune adulte, aussi blasé qu’ingénu, à mi-chemin du futur gendre idéal vaincu par l’esprit de sérieux et d’un reliquat acidulé de frasques d’éternel gamin.
Parvenu à l’échéance biologique de la vingtaine, il allait falloir solder les comptes de l’enfance et devenir l’endetté chronique de tout ce qu’on manquera à être en chemin. Du moins est-ce ainsi que rétrospectivement je m’imagine pris entre le marteau et l’enclume, écrasé d’avance sous l’injonction d’un jour devoir m’embaucher quelque part mais prenant cette terrible perspective plutôt à la légère.
À vingt ans, j’étais encore cet arrogant rigolard qui, deux ans plus tôt, avait inscrit au fronton de ma classe d’hypokhâgne au Lycée Henri IV : LACAN EST MORT TOUT EST PERMIS. Le dandy-maître de la psychanalyse venait de casser sa pipe au lendemain de la rentrée scolaire, le 9 septembre 1981. Hasard malencontreux, un de ses petits-enfants trônait au premier rang, parmi d’autres grosses têtes molles. Entre ce rejeton outragé et moi, l’insulteur profane de son grand-père sévère, le pugilat fut évité de peu. Promu à mon corps défendant en cet établissement d’élite, j’étais donc un élève dilettante et insupportable qui préférait arborer le dernier gadget de Pif le Chien à l’heure de la pause récréative que feuilleter avec une négligence calculée une édition défraîchie de L’Être et le Néant. Huit mois plus tard, je ferai partie des énergumènes exclus d’office avec un tas d’annotations déplaisantes sur mes bulletins : « Mauvais esprit », etc.
Moi, le natif pur jus de la rive droite, hanté depuis l’enfance par la vue quotidienne de ce peuple de marchands des quatre saison, aristos de la clochardise et putains à martinet aux abords des Halles, j’allais migrer en banlieue, au peu coté lycée du Raincy, et parfaire mon inadmissibilité à Normal Sup. Dont acte, en m’y reprenant à deux fois. Et tant qu’à redoubler mon échec, en bonne compagnie, autant le faire avec panache, en enchaînant les nuits blanches arrosées de Zubrowska, en effeuillant mon cœur d’artichaut à la moindre occasion féminine, en agitant ici ou là un drapeau noir rétif à l’austère socialisme mitterrandien, en alternant sur ma platine les vocalises grinçantes de l’ironiste punk Johnny Lydon et le clavecin moins tempéré qu’il n’y paraît du baroqueux Monteverdi. Le cul toujours entre deux chaises : révision in extremis et dissipation chronique.
[…]
3 janvier 2017
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même