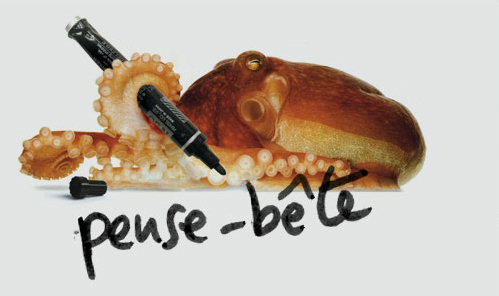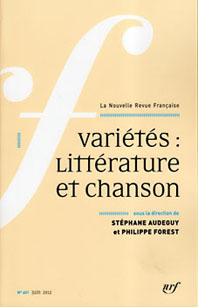14 juin 2012
[Tubes à l’essai (première série) —
extrait de la dernière livraison de la revue NRF.]
Stéphane Audeguy et Philippe Forest ont choisi de consacrer le numéro d’été de la NRF aux arts mineurs de la «chanson» et autres «variétés». Sujet tout bêtement inspirant, me suis-je dit, avant de répondre à l’appel, parmi une vingtaine d’autres auteurs, dont Annie Ernaux, Michaël Ferrier, François Bégaudeau, Arnaud Cathrine, Pierre Senges, Joy Sorman. D’ordinaire je me méfie des «commandes» de texte, mais là, j’avoue, ça m’a donné envie d’entamer une nouvelle série d’écriture brève. Il y a donc fort à parier que les cinq fragments, en lecture ci-dessous, auront une suite, dans les mois à venir, ici même.
Tubes à l’essai
Sus aux faiseurs de soupe / Et à tous leurs fans / Aux minets gominés… Début de l’été 76, à perte de vue, sur la pelouse jaunie, ratatinée, du Parc de La Courneuve, des crinières hirsutes, garçons & filles entremêlés, et sur la scène des inconnus qui monopolisent le micro : On entend dans le poste / Des musiques infâmes / Et nous… on est la riposte… Rock au rabais, la preuve par l’absurde. Tant de nullité, ça doit être au deuxième degré. Je m’informe alentour. Paraît qu’ils passent sur des radios commerciales, sauf que moi jamais entendu parler. Normal vu que cette chanson-là c’est la Face B, alors que leur premier tube, tout le monde l’a en tête : Oh les filles, oh les filles / Elles me rendent marteau… Ringard absolu, mais 100% fait exprès. Comme quoi, les apparences sont trompeuses. D’ailleurs, on se croirait à la fête de l’Huma, pourtant non, là c’est celle du PSU, nuance d’importance à l’époque. Bal Pop versus Woodstock. Et c’est quoi le nom de ce groupe qui ne joue pas le jeu, ni folk-song, ni pop planante, ni chanteur engagé ? Au bonheur des dames, c’est marqué sur le programme, entre Moulouji, Archie Shepp et François Béranger. Ça m’intrigue ce mauvais goût potache, peut-être parce que j’ai treize ans à peine révolus, l’âge du contre-pied permanent. Et tant pis si ça rime à presque rien leur refrain – Nous, on n’est pas des tristes, / On aime le twist –, suffit de regarder les choristes – l’un moustachu en robe fuseau léopard, l’autre couillu cuir sous perruque rose bonbon –, pour savoir à qui j’ai affaire, sauf que non, même pas pédés, d’après mes voisines déçues, travelos pour du beurre, postiche & pastiche, à cheval sur les préjugés, un comble d’ironie bitextuelle. Et qu’un sang impur / Ouais impur / Abreuve les microsillons / De nos 33 tours. Se foutre de la gueule du monde, à tel point de non-retour, ça essaime le trouble longtemps après. D’où une attirance précoce, sans que j’ose encore me l’avouer, pour la provoc foutraque, du moment que ça fait tache – variétés avariées de l’intérieur.
*
Sortant d’un cinéma d’art et d’essai, rue du Temple, ce même été 76, l’étrange sensation de faire encore partie du film que je viens de voir : Cria Cuervos. De ne pouvoir m’en échapper, non parce que chaque famille produit son enfer à huis clos, et chaque huis clos tout un tas de hantises totalitaires, sous Franco, chez mes parents ou ailleurs, mais au détour d’une confusion plus anecdotique : l’électrophone portatif d’Ana, la jeune héroïne, ressemblait à s’y méprendre à mon propre tourne-disque Teppaz. Méprise qui va me donner la chair de poule des mois durant, à chaque écoute de Porque te vas, ce 45 tours que ma mère m’avait offert, pour fêter le premier anniversaire de la mort du dictateur espagnol, galette fétiche qui me renfermait dans une chambre obscure où je croyais partager les mauvais rêves d’une petite sœur fictive, entre insomnie adultérine et sanglante agonie. À ce détail près que le titre de cette ritournelle, reprise en boucle, Porque te vas, porque te vas…, ne signifiait pas, comme je m’en étais persuadé, «Pourquoi tu vis ?», mais tout bêtement «Parce que tu t’en vas !», malentendu très récemment levé et dont l’écart de signification touche au secret espoir qui alors m’obsédait : que ma mère ose enfin quitter son mari, déserter le foyer conjugal, qu’elle s’en aille pour de vrai, pas seulement en pétitions de principe féministe, songes creux et vaines paroles aussitôt repenties.
*
Six mois après la mort d’Elvis Presley, j’avais presque oublié qui c’était, mais il a fallu qu’un autre événement vienne me le remettre en mémoire, par des voies détournées, maintenant qu’un de ses plus fervents sosies, Érik, complice de mes vacances en bord de mer, venait de se tirer une balle dans la bouche avec le 22 long rifle de son grand-père. «Don’t be cruel» me croonait encore Érik l’été précédent, en pommadant ses cheveux d’ébène d’un soupçon de gomina, avant de sculpter des deux paumes sa coupe de King amateur. Il avait la banane lustrée au cordeau et moi la tignasse blonde en boucles jusqu’aux épaules, rien pour nous entendre a priori, ni côté fringues ni rayon musique, aux antipodes. Lui blouson-teddy-boy-rockabilly, moi chemise-de-nuit-pop-psychédélique. Mais, en commun, une sainte horreur de la déferlante disco, Bee Gees, Patrick Juvet & co. Et, dans la foulée, l’art d’éviter les post-pubères du coin, soit trop kakous footeux soit trop pourris friqués. Les esseulés convergent parfois à leur corps défendant, quand leur marge extrême se touche. Lui en singeant l’éternelle jeunesse d’Elvis, et moi la fuite en avant de Joplin Janis. Deux modèles si opposés, et à l’arrivée, un même destin suicidaire. Alors Erik, sous le poids mort de son idole déchu, qu’est-ce qui lui a pris de se braquer à bout portant ? Sans doute marre de se cramer les ailes à tout petit feu, chez sa mamy gâteau et l’autre vétéran de l’Indo qui l’élevait à la dure, pas comme son faux cul de père, qui s’était fait la malle on ne sait où une fois l’épouse accidentée en bagnole. J’en ai tellement voulu au papy surarmé, prêt à flinguer le moindre crouille approchant sa bicoque, lui qui détestait qu’un hirsute dans mon genre fréquente son petit-fils, et ne se privait pas de me le faire sentir, en me broyant la main à chaque visite, pour montrer ce que c’était un homme à poigne, pas une lavette, une fiotte, une tantouze, parce que l’irascible vieillard aimait me faire la leçon sur la guerre des Gaules, ou comment les Romains, nuques rases et bien disciplinés, avaient vaincu ces barbares efféminés qui déjà faisaient honte à la France, avant de m’agripper quelques mèches, de tirer bien fort et de lâcher en conclusion : «Cheveux longs, idées courtes !» Une formule de son cru, du moins c’est ce qui me semblait, mais il a fallu que, par des voies détournées, je remonte à la source. En fait, Cheveux longs, idées courtes !, c’était un titre de Johnny Hallyday, de retour du service militaire, en 1966. La fameuse réplique du rockeur franco-français aux Élucubrations du simili hippie Antoine. Et là, ça me rajeunit d’un coup, parce que, même si ce j’étais à peine né, ce disque devait traîner chez mon grand frère, en tout cas j’en connais encore les paroles par cœur : Ma mère m’a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux, / Je lui ai dit, ma mère, dans vingt ans si tu veux, / Je ne les garde pas pour me faire remarquer, / Ni parce que je trouve ça beau, / Mais parce que ça me plaît. / Oh, Yeah ! Et à la fredonner sur le tard, je repense à Érik, sa gueule d’ange explosée par terre, et à l’arme du papy retournant comme un couteau dans la plaie. Pas facile de trouver sa place, de survivre à cette guerre civile – trop court, trop long –, autant ne plus y couper, déserter hors champ, tailler la route ailleurs.
*
Les années 70 tiraient à leur fin de règne giscardien : Ma bouche n’osera jamais / Lui avouer le doux secret / Mon tendre drame… C’était la voix d’un vieux copain, Jean-René, qui s’étranglait presque à l’autre bout du fil, parce que, désolé de me déranger, mais il ne savait plus où il en était depuis que Manuel l’avait serré dans ses bras, la veille au soir, après s’être tous deux introduit dans le cimetière Montparnasse, pour trinquer nuitamment sur la tombe de Baudelaire, un rite d’hypokhâgneux en mal de sensations posthumes, sauf que, au moment de se quitter en déclamant un dernier vers et puis retour au spleen estudiantin chacun chez ses parents, il y avait eu l’embarras d’une accolade, leurs lèvres manquant s’effleurer, presque un baiser volé, et Jean-René ne savait plus qu’en faire de ce pressentiment gênant qui avait repris corps dans son sommeil, sans le laisser une minute en paix. Lui, le fils de bonne famille – père diplomate, l’autre aux bonnes œuvres –, de quel foutu syndrome post-adolescent était-il atteint pour agiter ainsi sous ses draps le fantôme de Manuel, ce petit-fils de réfugié espagnol. C’était quoi cette tendresse irrépressible rien qu’à l’idée de le revoir en classe ce matin même, puis de le raccompagner tout à l’heure jusqu’au hall de son clapier HLM ? À quel saint si malsain se vouer : À ce garçon beau comme un dieu / qui sans rien faire à mis le feu / à ma mémoire. Faute d’avoir trouvé nulle part oreille assez fiable, il se rabattait sur moi, qui allait mettre un mot sur la chose et lui donner mon amorale bénédiction, mais comme je tenais là ma revanche sur cet enfant gâté qui me snobait une semaine sur deux, autant le laisser tourner autour du pot aux roses, jusqu’aux faux semblants d’un aveu : « Dis, tu crois que je suis pédé ? » Et moi, du tac au tac : « En tout cas, t’as l’air amoureux.» S’ensuivit une romance échevelée avec le capricieux éphèbe ibérique, sans que ça se sache surtout, et quelques liaisons vite fait entre mecs histoire de prendre un peu d’assurance. Entre-temps, pour amadouer sa mère, il avait trouvé la combine, lui emprunter un album de son chanteur préféré, Charles Aznavour, et repasser dans sa chambre soir après soir la même rengaine – Nul n’a le droit en vérité / de me blâmer, de me juger / Et je précise… –, espérant élargir en douceur l’étroitesse d’esprit de cette femme d’intérieur : Que c’est bien la nature qui / Est seule responsable si / Je suis un homme oh ! / Comme ils disent.
*
La peau amollie et gagnée par d’inquiétantes rougeurs, j’allais sortir du bain, décidément trop chaud, tandis que Sonia, rencontrée l’avant-veille, une fameuse nuit blanche du 10 mai 81, me soumettait au Blind Test de sa discothèque : «Et ça tu connais ? Moi, j’adore !» Ce devait être le dixième morceau qu’elle me faisait écouter par la porte entrebâillée. Son Hit-parade intime en partage, une autre façon d’apprendre à nous toucher. Suzanne Vega, j’avais dit «Bof, j’aime bien» ; Bruce Springsteen, «Nan, quelle horreur» ; Laurie Anderson, «Pas mal, c’est qui ?» ; Ian Dury, «Moi aussi j’adore!» Ensuite, juste avant de me redresser dans la baignoire, histoire de varier les plaisirs : T’aurais pas un truc en français ?» À peine demandé, sitôt changé de vinyle sur la platine. En attendant, je pataugeais, debout dans l’eau croupie. «Ça, c’est forcé que tu connaisses !» d’après elle. Et là, première déconvenue, l’accent familier de Claude Nougaro, du moins sa rumeur assourdie, déclamant une ode inconnue à mon répertoire : Mai, mai, mai, Paris mai… Impossible d’avouer mon ignorance sans trahir notre complicité naissante. Plus qu’à enjamber le rebord émaillé pour rejoindre Sonia dans la pièce à côté et, d’un simple coup d’œil au revers de l’album, déchiffrer le titre, comme si de rien n’était : «Ma chanson préférée, j’te jure !». C’était le défi à relever, un pied après l’autre sur le tapis de bain, plutôt mal d’aplomb d’ailleurs, sous le coup du choc thermique, ébouillanté puis cueilli à froid, dans un état déjà second, alors que je venais de saisir au vol quelques bribes de la chanson : Avec ma belle amie quand nous dansons ensemble / Est-ce nous qui dansons ou la terre qui tremble ? L’extrait fatidique avec sa drôle de question jetée en l’air ; et moi, tombant des nues, tout du long, sans connaissance, par terre.
Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même